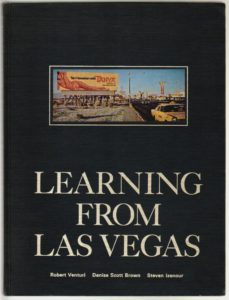Bellinzone. La capitale du canton latin, avec ses châteaux majestueux perchés sur des éperons rocheux offre de prime abord l’image d’une ville inscrite dans la pente. Cependant, à l’instar du Valais, cette partie du canton cisalpin a bénéficié des alluvions du Tessin pour se construire une horizontale exploitable, après que la fougue des eaux fut canalisée dès la fin du dix-neuvième siècle. Profitant de ces travaux, la cité de la Magadino a pu s’étendre et installer dans cette plaine asséchée la plupart de ses programmes publics. Au cours des années soixante, l’aéroport militaire fut désaffecté pour laisser le champ libre à un équipement majeur, considéré aujourd’hui comme un des chefs d’œuvre de l’architecture suisse et dont la notoriété a dépassé les frontières cantonales et nationales : les fameux bains publics de Bellinzone.
C’est pendant l’été 1967 que les jeunes architectes Aurelio Galfetti, Flora-Ruchat Roncati et Ivo Trümpy développent leur projet de concours et en remettent leur copie aux autorités communales. Anne Ruchat, la fille de la protagoniste du trio, se rappelle un « enthousiasme combattif de l’idée qui prenait forme » et qui contaminait l’équipe de projeteurs dans une volonté d’inscrire une « empreinte dans la vallée ». Le 25 septembre 1967, ils en sont désignés lauréats.
Après un référendum populaire dont l’issue fut favorable au projet, en septembre 1968, c’est finalement le premier août 1970 – date prémonitoire d’un destin national – que le maire de l’époque, Athos Gallino, inaugure l’ouvrage par ces mots : « Je suis certain que ceux qui étaient sceptiques initialement, sont au fond aujourd’hui eux-mêmes aussi convaincus du bienfondé de cette œuvre ».

Revoir cinquante ans après sa conception, une œuvre architecturale célèbre qu’on a visitée il y a plus de trente ans, m’a procuré à la fois une forme d’exaltation mais aussi une sorte d’appréhension : l’ouvrage aura-t-il résisté au développement urbain, les souvenirs de l’étudiant que j’étais auront-ils été enjolivés par le temps qui passe ? Mais même si la carbonatation, les mousses et les tags ont entamé l’épiderme de cette mégastructure territoriale, l’émotion a été au rendez-vous : l’icône moderniste traversant la plaine alluvionnaire dans un geste héroïque est devenue aujourd’hui une promenade à travers les arbres que les avions des années soixante avaient prohibés. Cette transformation du paysage confère à l’ouvrage un once de douceur supplémentaire et accompagne les différentes séquences d’accès aux bassins. Le parcours sous les branches se vit dans une forme de quiétude et d’apaisement qui réconcilie l’élégante brutalité originelle à un mode de vie contemporaine où la question de la présence de l’élément naturel est devenue quasi indissociable de la notion de bien-être.
Ce qui impressionne toujours dans cette première architecture du territoire en Suisse, une année après la parution de l’essentiel ouvrage de référence de Vittorio Gregotti « Le territoire de l’architecture » (1966), c’est la pertinence du concept qui allie le plan et la coupe en trois fonctions inséparables : premièrement relier la ville au fleuve par la grande passerelle piétonne, deuxièmement abriter les vestiaires par la couverture du tablier de l’ouvrage d’art et troisièmement présider aux descentes vers les bassins par un système d’escalier et de rampes dont les formes sculpturales s’inscrivent en écho à celles des plongeoirs. D’un point de vue urbain, on constate encore aujourd’hui la justesse et la précision des points de départ et d’arrivée de ce long parcours quasi initiatique au-dessus de la plaine.

Dans quelques jours des travaux de restauration importants de la passerelle vont commencer sous la direction de l’un des auteurs, Aurelio Galfetti, avec Carola Barchi. Gageons que ces derniers, dont les crédits ont été votés par la municipalité et qui vont s’étaler sur une demi-année, permettront à cette ligne de béton de s’affirmer de manière encore plus manifeste dans ce paysage incroyable et ceci pour la postérité.
+ d’infos
Anne Ruchat « L’eau, consolation du béton », in Bellinzona Grand Tour, FAS Ticino, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2018
Nicola Navone, Bruno Reichlin , Il Bagno di Bellinzona di Aurelio Galfetti, Flora Ruchat-Roncati, Ivo Trümpy, Mendrisio, 2010