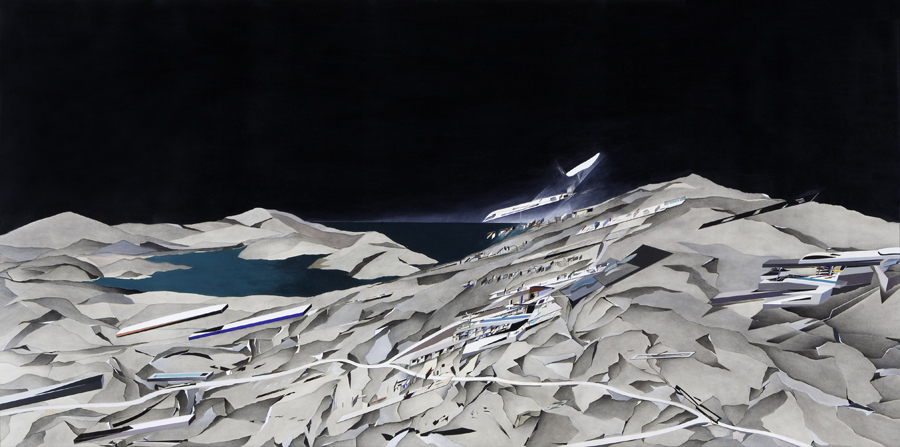Cet été, je parcours la Romandie par monts et par vaux à la redécouverte des premières œuvres de quelques bureaux d’architectes reconnus de cette région de l’ouest helvétique. Avec un recul de vingt années, ou plus, les réalisations présentées nous interpellent quant à l’évolution de la pensée architecturale contemporaine. Issus de concours ou de commandes privées, ces projets ont marqué les débuts prometteurs de leurs auteurs respectifs.
A peine revenus de Rome, où ils passèrent une année à l’Institut suisse, les architectes remportent leur premier concours pour ce bâtiment multi-usage dans la périphérie nord-ouest lausannoise. En cette période où l’influence de l’histoire sur la pensée architecturale est encore omniprésente, l’option prise ici se démarque du débat théorique en cours. Avec une définition claire des trois programmes – une petite antenne postale pour le quartier, des ateliers pour les services de la voirie et quelques logements –, c’est avant tout la fonctionnalité au sens moderne du terme qui va guider la conception. L’édifice pour la régie fédérale se situe en tête du volume, affirmant son caractère public par un grand cadre sur deux niveaux, puis on trouve les espaces industriels placés latéralement du côté nord, permettant aux logements de s’ouvrir au sud, face à la petite zone de villas pré-existantes.
Référence à la modernité. Tout en étant résolument tourné du côté de la modernité, parce qu’il évacue toute connotation historisante, le projet prend néanmoins comme point de départ conceptuel l’affirmation du théoricien Robert Venturi, pourfendeur dans les années soixante du dogmatisme et de l’orthodoxie moderne : « J’aime mieux les objets riches en significations que ceux dont la signification est claire; j’admets les fonctions implicites tout autant que les fonctions explicites » (« De l’ambiguïté en architecture », 1966). A Villars-Sainte-Croix, le parti est très clair dans l’acceptation du mélange des matières qui expriment chacune des trois fonctions : le béton armé pour la poste, le métal thermolaqué en gris pour la voirie, le bois peint en blanc et la brique de terre cuite pour les logements. Loin de l’unicité de l’enveloppe qui sera un des grands thèmes du langage architectural développé dans les années nonante, et qu’on a aussi appelé le minimalisme helvétique, la question à résoudre est alors la manière dont les différentes surfaces se rencontrent, principalement dans les angles de l’édifice.
Ce sont donc aux endroits précis des articulations volumétriques que les architectes font la démonstration quant à la maîtrise de toute la palette de composition architecturale dont ils disposent : les avant-toits deviennent couverts et s’imbriquent avec les barrières, les parois en bois et en brique se détachent l’une de l’autre par le biais mis en place, le béton de l’encadrement devient une plinthe pour détacher la brique du sol, la paroi en verre de la poste se dessine selon des principes compositifs des années cinquante, la grand porte d’entrée en bois naturel se meut par l’intermédiaire d’un pivot axial décalé, petite allusion à Le Corbusier qui en fait précédemment un usage remarqué.
Qualité typologique. Au delà de cette prise de position affirmée sur la question expressive, c’est également dans la mise en place de typologies d’appartements en duplex que l’attachement à la modernité se confirme. En effet, ce type d’habitation sur deux niveaux développé dès les années vingt a permis d’inventer toute une série de logements soit distribués par des jardins privés – projets hollandais –, des coursives extérieures – projets russes ou allemands – ou par les célèbres rues intérieures des Unités d’habitation corbuséennes. Si les exemples précités avaient pour dessein de permettre la mise sur le marché de logements sociaux, les cinq appartements dont il est ici question s’adressent à une population plus villageoise, qui a retrouvé dans cette proposition architecturale une référence à la maison traditionnelle locale où l’on accède simplement à son habitation par le sol naturel.
Cette même cohérence de pensée des architectes se remarque dans un projet élaboré à la même période, pour un immeuble de logements pour étudiants à Genève (1988-1993). En effet, ils y développent à la fois des écritures architecturales connotées spécifiquement en fonction de la position urbaine de la volumétrie articulée, avec des façades qui affichent des matériaux différents, mais qui jouent sur des déclinaisons de teintes très proches. De même ils y poursuivent leur recherche d’une diversité typologique au sein d’un bâtiment unique.
+ d’infos
Architectes : Patrick Devanthéry et Inès Lamunière (aujourd’hui : dl-c, dl-a), Genève
Lieu : Villars-Sainte-Croix, Vaud
Dates : 1986-1990
Acquisition : Concours, premier prix
1986 : Les architectes ont 32 ans, l’architecte Minoru Yamasaki, auteur des Twins towers de New York, décède, Jean Genet et Jorge Luis Borges disparaissent, Léo Ferret sort son double album « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans », le film de Sydney Pollack « Out of Africa », basé sur la nouvelle de Karen Blixen, obtient sept oscars à Hollywood dont celui du meilleur film.
PS: ce blog a été publié la première fois sur la plateforme de l’hebdo.ch