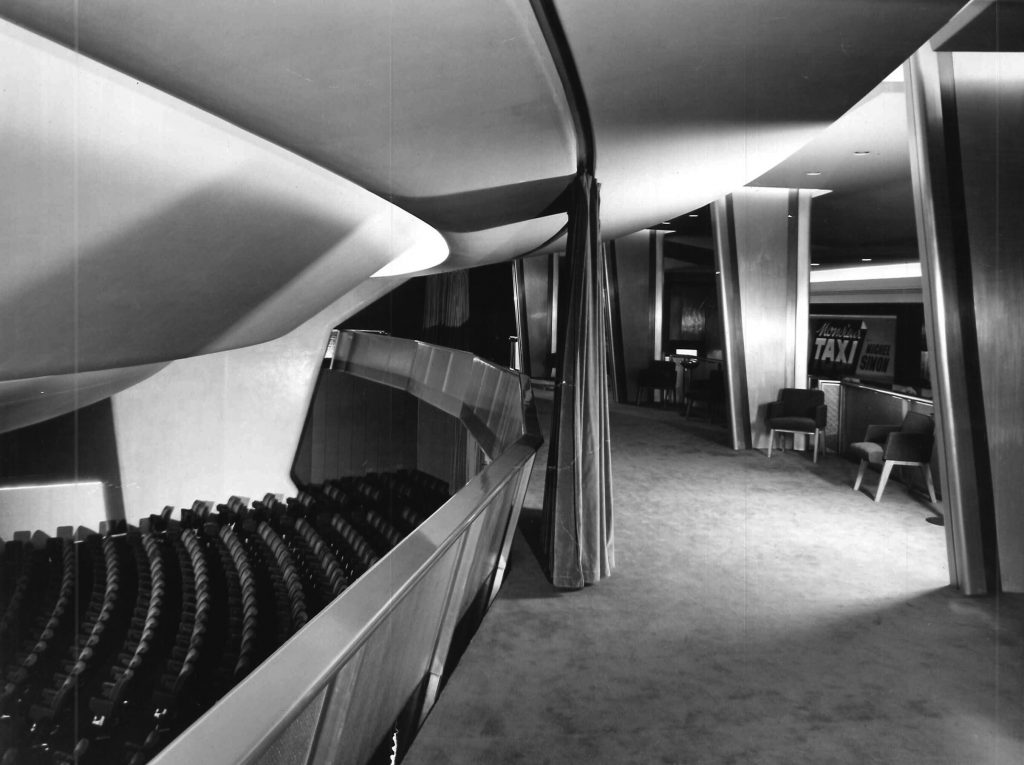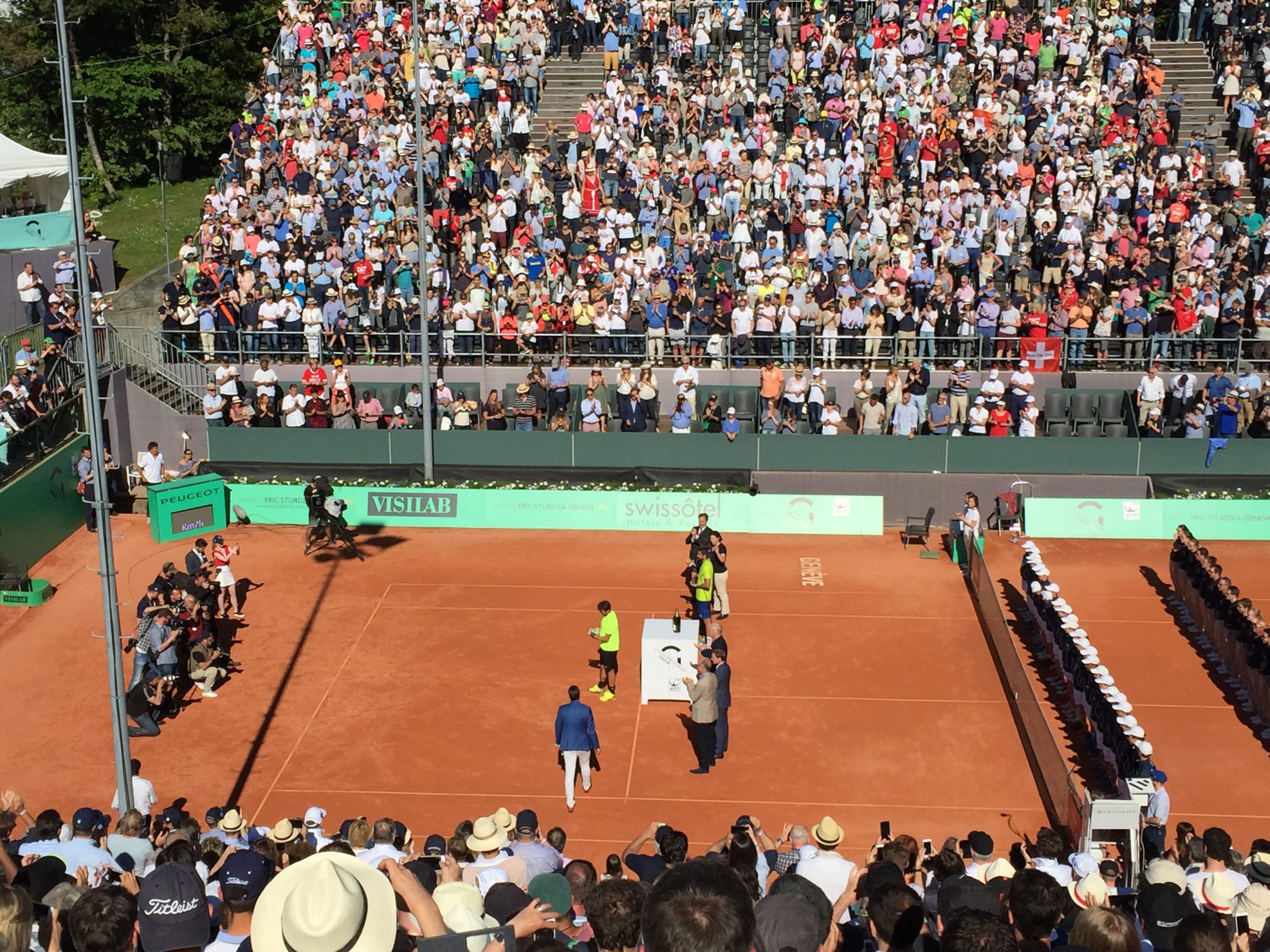Il y a une année déjà, le 11 janvier 2016, la planète hyper connectée apprenait la disparition de David « Lazarus » Bowie, androgyne polyforme des années septante, artiste complet, personnalité sensible et en accord avec son époque. Il avait planifié à travers la sortie de Blackstar, son ultime et digne révérence musicale, la conclusion d’une carrière hors norme. Clap de fin? Pas vraiment. Quelques deux mois plus tard, le magazine Newsweek informe que des morceaux inédits existent et évoque une possible édition à titre posthume d’ici fin 2017.
Le 21 avril 2016, c’est au tour de l’icône de la pop funk, « Prince » Rogers Nelson, de rendre l’âme dans un dernier souffle opiacé. Moins de deux jours après sa disparition, le journal Le Monde, annonce la présence de plus de cinq cents titres et se pose la question éthique de leur diffusion post mortem. En effet, conclut le journaliste, on ne peut intellectuellement pas « applaudir la vision intransigeante d’un artiste pour finalement la diluer après sa mort ».[1]
N’en a-t-il pas toujours été ainsi?
Le monde de la culture se perd parfois en conjecture sur l’attitude « juste » à adopter lorsqu’un artiste disparaît, laissant derrière lui une œuvre parfois considérée comme étant inachevée. Combien d’esquisses froissées ou de dessins abandonnés dans les cartons défraîchis par des créateurs fatigués n’ont-ils pas été reproduits par la rotative quadrichromique sans l’approbation du défunt? Combien de brouillons de manuscrits perdus dans les recoins de caves ou de galetas poussiéreux n’ont-ils pas fait les beaux jours des éditeurs en peine de pouvoir se renouveler? Combien de personnages de fiction célèbres n’ont-ils pas été exhumés des sépultures de leur auteur d’origine pour en poursuivre de « nouvelles » aventures de papier afin de garantir un rentable tirage?
Poursuivre à tout prix. Le domaine de la bande dessinée est peut-être celui qui, aujourd’hui, s’est le plus clairement positionné face à cette problématique d’ordre éthique qui consiste à poursuivre ou non une série à succès. Les aventures d’un célèbre héros doivent-elles en rester là où les a laissées un auteur désormais parti à jamais pour écrire d’autres histoires dans les limbes de l’inconnu? D’un côté se placent ceux pour qui la mort devient une acceptation sine die du terme de l’œuvre. Ici se range l’arrêt définitif des reportages de Tintin, au lendemain de la mort de Georges Rémy – que l’on nuancera néanmoins par la parution en 1986 des esquisse réunies dans le vingt-quatrième et ultime album : « Tintin et l’Alph’art ». De l’autre, s’affichent les poursuiveurs d’icônes du huitième art, qui sous couvert d’une pseudo-fidélité au lectorat, exploitent la « franchise » d’un personnage, dont la silhouette familière permet d’alimenter les comptes bancaires d’héritiers en mal de reconnaissance. Grâce aux tenants de cette deuxième approche, aujourd’hui la plus répandue, certains héros (cow-boy solitaire, groom hyperactif ou ancien capitaine de la RAF) ont survécu à leur géniteur par l’habile trait de crayon de jeunes imitateurs talentueux qui s’approprient et recyclent un modèle appartenant autant à l’imaginaire collectif qu’à la maison d’édition.
Qu’en est-il du monde de l’architecture?
Le récent achèvement du mémorial Franklin D. Roosevelt, qui plonge sa poupe de granit blanc dans les eaux grises de l’East River, quarante ans après la mort de son auteur, Louis I. Kahn, offre l’opportunité de s’intéresser au débat.
Précisons tout d’abord que les enjeux et les investissements des communautés de la plume, du crayon ou du vinyl permettent de prendre certains risques financiers, autres que ceux engendrés par une construction immobilière. Remarquons ensuite que le septième art, impliquant des productions parfois plus élevées que celles du domaine bâti, a récemment franchi un pas en faisant fi de la présence humaine, grâce à la numérisation hyperréaliste permettant de remplacer un acteur disparu par son double virtuel. Le dernier opus de la saga Star Wars, « Rogue one » sorti en décembre 2016, l’ayant admirablement démontré avec la reprise du personnage, le Grand Moff Tarkin, son acteur Peter Cushing qui l’avait créé en 1977 ayant disparu en 1994. Une pierre de plus à l’édifice de cette réflexion quant à la nécessaire présence physique, et donc vivante, de l’auteur d’un projet culturel.
Acte de bâtir. Un préalable est cependant nécessaire pour mieux appréhender la question fondamentale de la genèse de la production architecturale de la fin du vingtième et du début du vingt-et-unième siècle. Contrairement à l’écrivain, au dessinateur, au peintre ou au sculpteur, la particularité du domaine architectural est caractérisée par la dissolution de l’acte créatif à travers différents intervenants. L’aboutissement en est un volume construit qui émerge à la fin d’un long processus, ce dernier lui conférant, sur ce plan, une similitude avec le septième art. En effet, si l’espace – terme au combien indéfinissable et abstrait – se conçoit au départ très intellectuellement et très abstraitement, sa concrétisation nécessite de nombreux intermédiaires qui impliquent des dessins, des calculs et surtout des artisans qui en matérialisent les contours. Vu sous cet angle très séquentiel, il pourrait paraître simple de conclure que la disparition de l’architecte – un des maillons de cette longue chaîne opérationnelle – ne devrait pas poser trop de problème pour réaliser, de manière temporellement décalée, un travail imaginé en amont.
Or il n’en n’est rien et l’appréhension de cette thématique est somme toute assez complexe car elle renvoie presque toujours à la figure de l’architecte concepteur.
Pour corroborer ces interrogations, deux exemples viennent immédiatement à l’esprit : ce sont les reconstructions de deux bâtiments éphémères ayant marqué durablement l’histoire de l’architecture. Tout d’abord le Pavillon de l’Esprit nouveau (Le Corbusier et Pierre Jeanneret) réalisé pour l’exposition des Arts décoratifs à Paris en 1925, qui fut refait à l’identique en 1977 à Bologne par José Oubrerie et Giuliano Gresleri. Son presqu’alter ego, celui de l’exposition universelle de Barcelone de 1929, le fameux Pavillon de Barcelone, dû à Ludwig Mies van der Rohe a été rebâti entre 1983 et 1986, par Cristian Cirici, Fernando Ramos et Ignasi de Solà-Morales sur un emplacement légèrement décalé par rapport à celui original. Dans les deux cas, il s’est agi de reconstruire un objet ayant déjà préalablement existé. Dans les deux cas les « nouveaux » architectes ont passé un nombre incalculable d’heures en analyse de plans et de photographies de l’époque pour ne pas trahir l’essence du projet originel. Dans les deux cas un des membres de l’équipe a été un historien de l’architecture démontrant que, malgré la pré-existence bâtie, la pertinence de la juste adéquation à la conception première a été recherchée.
Pour compléter cette première approche de réflexion, on peut citer deux autres réalisations célèbres qui étaient commencées mais en cours de chantier lors du décès de leurs auteurs respectifs : il s’agit de la « Sagrada Familia », l’organique et géante nef d’Antonio Gaudi, et de « Saint-Pierre de Firminy », la canonique et sculpturale église du même Le Corbusier, commencée cinq années après sa mort, sous la conduite de son ancien bras droit, le déjà cité José Oubrerie. Deux objets laissés au stade de « ruines vivantes », où malgré ce caractère inachevé, un substrat matériel partiel fut à disposition de ceux qui durent reprendre le flambeau afin d’offrir à la lumière un écrin bâti bien réel. Ici la genèse de l’œuvre était à la fois présente sur le site, mais également enfouie dans des dessins et des maquettes.
Four freedoms park. Pour revenir au projet new-yorkais, les données étaient encore différentes : le projet n’était pas complètement développé et n’était illustré que par quelques croquis et dessins, et par un testament oral demeuré célèbre sous la forme d’un texte énigmatique du maître américain : « J’avais en tête que ce mémorial devait être une chambre et un jardin » [2]. C’était en 1973, soit une année avant la disparition de l’architecte. Cette année-là le projet est officiellement annoncé par le maire de l’époque, John Lindsay, comme devant prendre place au milieu de l’East River, à la pointe sud de ce qui s’appelle désormais la Roosevelt Island. Le projet fut repris en 2005, à une époque où la figure kahnienne était médiatiquement mise en avant par le très bel hommage cinématographique de son fils Nathaniel (« My architect, A son’s journey », Oscar du meilleur documentaire en 2004). Le projet put renaître sous l’égide de Gina Pollara, qui fut en parallèle co-curatrice d’une grande exposition de dessins de Kahn, et de William van den Heuvel, ancien diplomate américain qui fut le catalyseur permettant la récolte des cinquante-trois millions de dollars nécessaires à sa réalisation. L’opération a duré sept années et n’a pas pu compter sur d’anciens collaborateurs du concepteur, ni sur des plans d’exécution au sens technique du terme. Cependant, les archives recelaient de nombreux détails de l’époque esquissés par le maître de Philadelphie. Dès l’origine, il s’agissait de bâtir un parc et un monument à la mémoire de l’ancien président américain, et plus particulièrement, à celle des paroles de sa fameuse allocution du 6 janvier 1941, prononcée lors du rituel discours sur l’Etat de l’Union, resté dans l’histoire sous le titre des « Four freedoms ».
Après près de quarante années d’une longue épopée, le site a été ouvert au public en octobre 2012.
Lorsqu’on aborde la critique de ce type de projet, un peu mythique, on doit se résoudre à ne pas s’abandonner à la contemplation d’un ouvrage rare dû à une des icônes de la pensée architecturale du vingtième siècle, mais bien de continuer à s’interroger sur le fond du débat. Fallait-il réaliser ce projet quand on sait qu’il ne figure que sur une seule page de la première grande monographie consacrée à Louis I.Kahn, publiée à Zurich en 1977 [3], et uniquement sous la forme de dessins déjà posthumes, puisque datés du 11 avril 1975? Et si oui, l’a-t-il été dans l’esprit de sa conception des années septante? A ces deux légitimes questions, on peut aujourd’hui répondre par l’affirmative. Tout d’abord, parce que le programme, à l’image des deux pavillons précités, peut se résumer à une pure spatialité, dont la présence s’affiche au delà des modes, des évolutions sociétales ou des progrès technologiques. Ensuite parce que la réalisation est exemplaire : d’abord parce que les américains savent souvent très bien construire, principalement sur le plan culturel, et ensuite parce qu’elle s’appuie fidèlement sur les précieux documents archivés dans le fonds dédié à Louis I. Kahn à l’université de Pennsylvanie.
Le monument se présente sous la forme d’un immense cénotaphe à ciel ouvert, une architecture de sol, où les géométries élémentaires, chères à l’architecte, s’inscrivent dans ce morceau de territoire que l’on pourrait qualifier de « bout du monde ». Le jardin en légère pente s’inscrit dans un triangle bordé symétriquement par deux fois soixante Tilia cordata (tilleuls à petites feuilles) de presque vingt ans d’âge. La « chambre » – « the room » – qui achève la composition et la séquence architecturale est composée de cent-nonante blocs de granit, dont certains atteignent les trente-six tonnes. Ils ont été déplacés de la même manière que le firent les égyptiens de la haute Antiquité, à savoir dans de grandes fosses de sable où ils purent être être tournés lentement sans endommager les angles. Cette mise en œuvre aurait plu à son concepteur, lui qui, lors de son voyage en Europe entre 1928 et 1929, a rempli ses carnets de croquis de monuments antiques qu’il admirait tant et qui furent la source d’inspiration d’une grande partie de sa pensée et de son œuvre.
Au-delà de ces aspects techniques, c’est bien l’esprit de Kahn qui affleure dans chacun des détails reproduits avec un soin presque dévotif, caractéristique de nos cousins d’Outre-Atlantique lorsqu’ils ont décidé de rendre hommage à un de leurs pères. Les proportions de ces « colonnes » en pierre sont admirables et le joint d’un pouce – 2.54 centimètres – laissé entre elles confèrent à la « chambre » un caractère typiquement kahnien quand on connaît son obsession pour cet espace qui était pour lui « le commencement de l’architecture […] le lieu de l’esprit ». Enfin le cube parfait faisant office de porte d’entrée au mémorial, renvoie à des notions de formes platoniciennes qui furent à la base des réflexions de Louis I. Kahn sur la composition architecturale. Sur la face sud de cet objet en hommage à la géométrie élémentaire grecque est gravé, à la main, le texte intégral de Franklin D. Roosevelt. Il s’offre symboliquement au monde, puisque la « chambre » est ouverte sur la rivière, et sur son au-delà qu’est l’océan. Cependant le symbole est encore plus puissant, car le discours s’adresse en fait directement aux peuples du monde. En effet la tour du siège de l’ONU – dont Le Corbusier avait esquissé les principes volumétriques et qui domine placidement le chef d’œuvre posthume de cet autre grand génie du vingtième siècle – crée le lien métaphorique entre la parole du président des Etats-Unis d’Amérique, et sa possible réception par les cent-nonante-trois états membres de l’institution.
+ d’infos
[1] http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/04/23/mort-de-prince-est-il-ethique-de-publier-des-inedits-posthumes_4907455_1654986.html#f2KuX3kSw2kbkjqq.99
[2] Texte complet et original de Louis I. Kahn lors d’une conférence au Prat Institute en 1973 : « I had this thought that a memorial should be a room and a garden. That’s all I had. Why did I want a room and a garden? I just chose it to be the point of departure. The garden is somehow a personal nature, a personal kind of control of nature, a gathering of nature. And the room was the beginning of architecture. I had this sense, you see, and the room wasn’t just architecture, but was an extension of self ».
[3] Heinz Rohner, Sharad Jhaveri, Alessandro Vasella, Louis I. Kahn Complete work 1935-1974, Institute for History and Theory of Architecture, EPFZ, Zurich, 1977.
PS: ce blog a été publié la première fois sur la plateforme de l’hebdo.ch